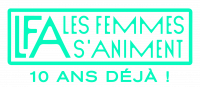DANA SARDET
monteuse et réalisatrice
co-fondatrice de MUSIDORA, le premier festival international de films de femmes
San Francisco & ses débuts
Née dans le Queens, à New-York, Dana Sardet vient en Europe pour la première fois à l’âge de 14 ans pour étudier le français dans une école en Suisse. L’expérience lui plaît tant qu’elle rêve de revenir y vivre un jour. De retour aux États-Unis, elle poursuit des études à l’université en histoire de l’art et se destine à la vie académique mais décide finalement de suivre son futur mari, Christian, à San Francisco où il étudie à Berkeley. « On a vécu toute cette période incroyable, le foisonnement des débuts du mouvement des femmes mais aussi la créativité, les flower children... C’était très important comme formation pour moi. Je travaillais dans une entreprise mais c’était aussi l’ambiance [de San Francisco]… »
À cette époque, Dana s’est déjà découvert une passion pour le film au sein du Club Cinéma de son université avec lequel elle réalise des petits projets.
« J’avais fait deux films en 16mm pour notre université avec des copains. J’ai découvert un monde que je ne connaissais pas, la technique de fabrication de films, et ça m’a donné envie. »
À San Francisco, elle trouve du travail comme monteuse dans une société de production de dessins animés éducatifs. « C’était à l’époque de Sesame Street qui était une grande émission à la télé pour les enfants. On faisait des petits clips en dessins animés avec une méthode d’image par image sur cellulo. Je regardais ça un peu de loin parce que j’étais monteuse mais j’étais très amie avec les gens du Art department qui, eux, faisaient les dessins et les découpages. Les personnages étaient faits en papier découpé et collés sur les cellulo puis filmés avec une caméra Arriflex 16mm. C’était superbe comme formation. » Le processus de montage de ces dessins animés en 16mm est compliqué, bien loin de ce que Dana utilise aujourd’hui pour monter ses films. « On ne peut plus imaginer la difficulté technique. Dans les années 60, et début 70, on coupait le film ; il fallait gratter l’émulsion avec la lame de l’outil appelé « colleuse »; puis on mettait un peu de colle liquide, et on collait les deux bouts de film ensemble. La colleuse était chauffée pour que la colle sèche rapidement. C’était extrêmement technique et difficile car il fallait garder le tout sans poussière, sans rayures… J’adorais ça, le côté technique. »
En parallèle, Dana réalise son premier film : un documentaire de 26 minutes consacré à Lyle Tuttle, un tatoueur de San Francisco devenu une légende du milieu depuis, et connu notamment pour avoir tatoué Janis Joplin et d’autres femmes à une époque où la majorité des tatoueurs ne travaillaient que sur les hommes. Tuttle a une histoire fascinante que Dana souhaite immortaliser. Comme dans la plupart de ses films, explique-t-elle, c’est lui qui parle de son histoire. « J’ai un style : il y a rarement de voix off, c’est toujours les gens qui parlent. Lyle explique ce qu’il fait, pourquoi il est devenu tatoueur et on le voit en train de travailler. C’est un film passionnant. »

Paris & Musidora, premier festival international de films de femmes
En 1972, Dana quitte les États-Unis pour Paris aux côtés de son mari. Elle parle encore très peu français et se lie d’amitié avec d’autres expatriées américaines installées dans la capitale. « Il y avait un groupe international de femmes qui s’appelait NOW (National Organization for Women) et qui était basé aux États-Unis. Elles avaient une antenne à Paris et je me suis mise en contact avec elles pour rencontrer des gens. C’était vraiment passionnant parce que c’était l’époque où on luttait pour l’avortement, pour la contraception. Les luttes étaient basiques et très importantes. Et puis, quelques-unes d’entre nous ont décidé de faire un festival de films de femmes. »
C’est dans ce contexte que Dana évoque avec modestie son rôle dans la redécouverte et la publication des mémoires d’Alice Guy. « [Nicole Lise Bernheim] était journaliste pour Le Monde et Le Nouvel Observateur. Elle a écrit de nombreux livres, et a, entre autres, travaillé avec Marguerite Duras sur India Song. Pendant ses recherches, elle a découvert l’autobiographie d’Alice Guy, la première femme qui avait réalisé des films dès 1896. Je sais que maintenant Alice Guy est très reconnue ; il y a eu des documentaires sur elle récemment. » Mais à l’époque, bien qu’Alice Guy ait réalisé et produit des centaines de films, son nom est tombé dans l’oubli au profit de celui, par exemple, des Frères Lumière. En allant rendre visite à sa famille aux États-Unis, Dana récupère le manuscrit d’Alice Guy conservé jusqu’alors à l’American Film Institute et le rapporte en France. Il sera mis en forme et préfacé par Nicole Lise Bernheim avant d’être publié en 1976 grâce à l’association Musidora.
En 1973, Dana Sardet, Nicole Lise Bernheim, et d’autres femmes ont l’idée de créer le premier festival international de films de femmes, Musidora, du nom de la célèbre actrice et réalisatrice. « C’était notre muse, une femme libre à l’époque des films de Feuillade. Elle a commencé dans le cinéma muet. Elle se montrait avec une cagoule noire. C’était son personnage : la vamp. Claire Bretecher a repris ce costume [pour dessiner l’affiche du festival] : la cagoule noire et les collants justaucorps avec la mitrailleuse. On a trouvé ça assez extraordinaire. »
Sans subvention officielle, elles organisent l’intégralité du festival elles-mêmes. Dana est secrétaire générale de l’association qu’elles créent pour l’occasion, mais elle ne maîtrise pas encore assez le français, laissant donc à ses collègues le soin de s’occuper des réunions et se consacrant plutôt aux recherches de cinéastes du monde entier. « Je ne parlais pas très bien le français, à l’époque. Je me débrouillais mais je ne pouvais pas vraiment m’entretenir avec les gens. Alors je suis allée dans les archives et j’ai cherché des noms de femmes [réalisatrices] partout dans le monde. Il y avait surtout des québécoises, qui étaient très actives, comme Anne-Claire Poirier, Mireille Dansereau… Des femmes extraordinaires. » Toutes ces femmes, raconte Dana, sont venues à Paris pour le festival par leurs propres moyens. « On n’avait pas d’argent. Elles sont venues de leur propre volonté, d’abord parce que c’est super de venir à Paris pour quelques jours, et puis on pouvait les héberger chez nous. C’était vraiment une époque fabuleuse pour ça. » Mais le festival projette également les films de réalisatrices disparues et oubliées par l’Histoire de l’industrie. « On a cherché aussi dans le passé. Par exemple, on a redécouvert Jacqueline Audry qui avait eu un certain succès avec des films parlants en noir et blanc. »
A l’issue d’un travail de recherche et d’organisation impressionnant, Dana, Nicole Lise, et des dizaines de collègues proposent une programmation qui s’étale sur dix jours dans la capitale, mettant en lumière la multitude de femmes travaillant dans le cinéma malgré leur sous-représentation officielle. « Il y avait des femmes, mais ce n’était jamais connu. A Cannes, par exemple, il n’y avait [presque] jamais de femmes dans le jury. Pendant des années et des années on était vraiment mal représentées. C’est pareil dans tous les domaines, mais dans le cinéma c’était flagrant. Et ce n’est pas qu’on manque de volonté ou de talent… » Avec la création de ce festival, Dana et ses collègues deviennent des pionnières de ce type de festival consacré entièrement aux femmes qui travaillent dans l’industrie. Une action fondatrice qui sera poursuivie quelques années plus tard par Jackie Buet et Elisabeth Tréhard qui lancent le Festival international de film de femmes de Créteil qui célèbrera cette année sa 45ème édition. « C’était une époque où on était les pionnières. On était fières, et on a reçu beaucoup d’accolades. Je crois qu’on a aidé à changer les choses. On était contemporaines de Gisèle Halimi, qui est maintenant reconnue à juste titre, Simone Veil, et des femmes de cette envergure-là. Ce sont elles qui ont vraiment fait avancer les choses mais il fallait agir dans tous les domaines. »
Les films programmés dans le cadre de Musidora sont projetés entre autres au cinéma L’Olympic et au Musée d’Art Moderne, mis à leur disposition pour l’occasion. Le festival est marrainé par des grands noms du cinéma français, et rencontre un succès incroyable. « Nous avons eu un écho extraordinaire via le Musée d’Art Moderne, avec Suzanne Pagé [qui dirigeait l’ARC]. Il y avait aussi Frédéric Mitterrand, le neveu de François Mitterrand, qui avait un cinéma de 3 salles, L’Olympic, dans le XIVème arrondissement et ces deux lieux nous ont été offerts pour notre festival. On a eu dix jours de programmation. C’est incroyable le retentissement que ça a eu… » D’autant plus que le succès du festival est dû à « la bonne volonté » des organisatrices et à leur travail acharné. « À l’époque il n’y avait pas de subventions, rien du tout. Tout le monde travaillait bénévolement. On était nombreux, et des gens très qualifiés. On avait comme marraines Agnès Varda, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, des femmes extrêmement bienveillantes. Organiser un festival de cette envergure… je dirais que c’était une gestation de neuf mois ! Et ensuite, le succès a été phénoménal. [Au printemps 1974], on a été invitées à Nice (en même temps que le festival de Cannes) pour organiser un mini festival de films de femmes dans une MJC. Évidemment, il n’y avait pas grand monde parce que tout le monde était à Cannes mais on a quand même eu un certain écho dans les médias. »
Dana souligne l’importance, à l’époque, d’organiser un festival célébrant les femmes travaillant dans l’industrie du cinéma, évoquant sa propre expérience alors qu’elle travaille elle-même comme monteuse à Paris. « C’était clair. À Cannes par exemple, il n’y avait jamais de femmes réalisatrices. Seules les œuvres des hommes étaient présentées. Et on le savait pertinemment parce qu’on était des femmes qui travaillent dans le cinéma. Moi j’avais, par exemple, travaillé comme stagiaire dans des salles de montage dans le XVIème arrondissement : j’étais la fille stagiaire qui était dans le coin de la salle noire. Devant moi il y avait un jeune homme stagiaire, et il y avait l’assistant monteur. C’était insupportable, j’ai tenu deux mois enfermée avec [eux] et je ne pouvais pas supporter. J’étais méprisée et c’était horrible. Ce n’est pas une revanche mais j’ai compris l’importance de donner l’opportunité aux femmes de s’exprimer directement par leurs propres films. »
Grâce au festival Musidora, Dana rencontre des dizaines de femmes qui travaillent dans le cinéma à Paris. « J’ai travaillé en tant que stagiaire mise en scène avec Michèle Rosier qui était styliste, et qui est devenue réalisatrice de films. Elle a fait deux grands films qu’elle a financés elle-même : George qui ? sur George Sand, et le deuxième était le film sur lequel j’ai travaillé en 1975 : Mon cœur est rouge. On peut dire que c’est un film un peu féministe qui se passe à Paris, qui suit une jeune femme libre dans ses mouvements [rires]. La jeune femme était incarnée par Françoise Lebrun. Ça n’a jamais eu un énorme succès, à l’époque on était vraiment marginales, hein, les femmes qui réalisaient… »

Sud de la France & ateliers pour les enfants
Quelques années à Paris suffisent à Dana qui a du mal à supporter la capitale et aspire à autre chose. Son mari est muté dans le sud de la France et ils descendent s’y installer. C’est là que Dana commence la deuxième partie de sa carrière. Si elle continue à réaliser de nombreux documentaires, elle commence également à animer des ateliers avec les enfants dans une MJC de Nice. « C’était le choc parce qu’à part le Festival de Cannes, et quelques tournages aux Studios de la Victorine, il n’y avait pas de production de cinéma [dans le sud]. Tout le monde montait à Paris. Alors j’ai essayé de démarrer un atelier de cinéma pour les enfants dans une MJC. On était aidés par l’INA. J’avais déjà un atelier pour les enfants sur place à l’époque. On appelait ça « Atelier de création », on faisait de la peinture, des petites choses en papier mâché. Quand l’équipe de l’INA est venue, ils nous ont proposé de créer un « Atelier Super-8 », et avec le directeur de la MJC, nous avons dit oui tout de suite. Pendant 2- 3 ans on a fait un Atelier de cinéma et création en Super 8 parce que c’est le matériel qu’ils nous ont proposé et ça marchait super bien. C’était vraiment très facile, on pouvait même mettre le son directement sur le film. On a réalisé des dizaines de films très intéressants, et des dessins animés. »
Après la fermeture de la MJC, Dana estime qu’elle a une responsabilité envers l’INA qui avait fourni le matériel et décide de le récupérer afin de poursuivre son travail avec les enfants dans les écoles de la région. Elle entre en contact avec le réseau de la pédagogie Freinet et leur Institut Azuréen de l’École Moderne qui reçoit très positivement son travail. En 1996, Dana fonde sa propre association à but non-lucratif, Vidéo Village, avec laquelle elle réalise des dizaines de films. Malheureusement, la majorité de ces films sont en Super 8 et elle regrette de ne pas pouvoir les transférer en une meilleure qualité pour les conserver sur sa page Vimeo : « je me suis dit que c’était une époque révolue et tant pis ! » Jusqu’en 2010, Dana continue de travailler avec des classes dans les écoles : « [l’instituteur⋅rice] assurait l’écriture du scénario, et je venais faire des décors et les personnages découpés et articulés avec les élèves. On faisait ça en petit atelier dans les classes, sur un projet pédagogique qui était financé à l’époque par des « Contrats bleus » pour permettre à des intervenants extérieurs de venir dans les classes. Il y avait aussi des danseurs, des musiciens, et moi je venais avec ma petite activité de dessins animés. » Dana a animé quelques rares ateliers avec des adultes, mais elle préfère travailler avec des enfants. Quand je lui demande si le choix de travailler avec des enfants était pour elle un moyen de transmettre les valeurs de justice, d’égalité et d’écologie dont elle me parle au fil de notre entretien, Dana approuve. « Ah oui, ça c’est sûr. J’ai fait Baléno [un des dessins animés réalisés dans une école maternelle !] avec une amie artiste/activiste de Greenpeace. C’est elle qui conduisait les séances de peinture. À l’époque, Greenpeace [était connu pour] sauver les baleines. C’était bien avant les causes actuelles qui sont encore plus graves et urgentes, mais pour amener l’idée de sauver la mer, c’était le thème de ce petit dessin animé. Il date d’il y a presque 20 ans. »
Si elle a également réalisé des films en live-action, surtout avec des collégiens, la majorité de ses ateliers ont donné naissance à des dessins animés dont l’histoire était entièrement inventée par les enfants. « Le dessin animé ça donne une liberté d’expression parce que les enfants, surtout à l’âge du collège, ont l’idée de se montrer. Pour l’écriture du scénario, il y a toujours la star, la vedette, la personne qui est mise en avant. Tandis que dans un dessin animé, il y a une certaine abstraction, une distance qu’on met entre les personnes. Pour un travail collectif, c’est idéal parce que tout le monde trouve une place. Il y en a qui dessinent bien, il y en a qui adorent enregistrer dans le micro, il y en a qui aiment bouger les personnages. Alors on faisait des petits ateliers à côté, quand la classe était encore en action avec leur instit, et ça permettait à tout le monde de participer. Tandis qu’un film de live-action, et j’en ai fait plusieurs, il y avait toujours trois ou quatre élèves qui étaient privilégiés par rapport aux autres parce qu’ils jouaient. Et je n’aimais pas du tout ce concours de popularité. »

Aujourd’hui, Dana est à la retraite et vit toujours avec son mari Christian dans le sud de la France où elle est devenue apicultrice et apprécie la nature en prenant soin de son jardin. Elle affirme être restée une « marginale » dans le cinéma, et elle est fière d’avoir partagé sa passion avec les élèves de ses ateliers, et avec ses deux fils à qui elle a appris à fabriquer des dessins animés lorsqu’ils étaient enfants. L’un d’eux a même continué sur les pas de sa mère en devenant réalisateur de documentaires, et en ouvrant une société de fabrication de films au Canada. Dana m’a confié qu’elle était très heureuse de pouvoir raconter son parcours, et je suis honorée de l’avoir recueilli. Il y a 50 ans, le festival Musidora fut le premier à mettre en lumière le travail d’une multitude de femmes invisibilisées par l’industrie du cinéma, et c’est dans une démarche similaire que s’inscrit la série de portraits LFA, une occasion parfaite pour ainsi rendre femmage à Dana et son travail pionnier à son tour…
À voir, certains de ces films sur Vimeo :