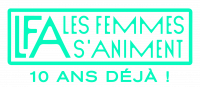Note sur le contexte de l’interview :
Cette interview a été réalisée en Mars 2021 en pleine pandémie de Covid-19. J’ai recueilli ces propos alors que j’étais moi-même expatriée au Japon. J’ai préparé et écrit cet échange dans le but de mettre en lumière certains aspects peu abordés de ce pays qui nous est très cher dans le milieu de l’animation. Recueillir les récits de Claire et Michiru m’a aidé à comprendre le choc culturel que je vivais en parallèle et j’espère qu’ils pourront résonner en vous, lecteur·rice·s, que vous soyez en quête d’aventure nippone ou non.
Etre une femme expatriée dans un pays si différent, notamment en matière de patriarcat et de conditions de travail, est un vrai défi. Nous avons toutes les trois ressenti des difficultés mais aussi beaucoup d’accomplissement et d’enrichissement. C’est ce que reflète ce double portrait : à la fois des parcours professionnels passionnants mais aussi une approche plus sociétale de l’expatriation. Vous découvrirez en quoi les parcours de femmes sont souvent bien différents de ceux des hommes.
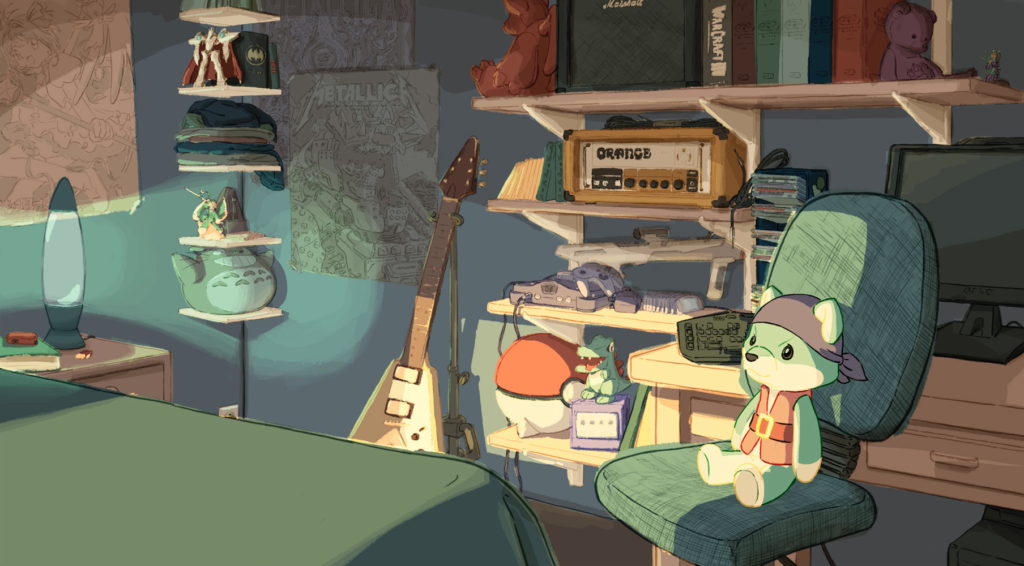



Claire Matz – Décor 2D, exercice de 3e année Gobelins / Layout 2D, film “OASIS” / Design, projet personnel / Modèle vivant
Ivy: Quel a été votre parcours scolaire ? Par la suite, comment êtes-vous arrivées au Japon ? Pourquoi avez-vous choisi de venir travailler au Japon ?
Michiru :
Je ne suis pas vraiment “arrivée” au Japon puisqu’en fait j’y suis née. J’ai quitté le Japon lorsque j’avais 3 ans et, quand j’étais adolescente, je suis revenue à peu près tous les ans voir ma famille. J’ai été élevée entre ces deux cultures et ces voyages réguliers m’ont permis de ne pas totalement perdre contact avec le côté japonais. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis là. J’ai commencé par faire de l’illustration à l’école Estienne. Puis, j’ai fait un BTS “cinéma d’animation” au LAM (Lycée des Arts et Métiers de Luxembourg) et après, je suis entrée à l’école des Gobelins, comme Claire. En 2016, j’ai fait mon stage de 3ème année au Japon et cela a été le tremplin vers le reste. Les Gobelins et le studio Digital Frontier à Tokyo avaient établi un partenariat pour offrir chaque été, à un élève voire deux des Gobelins, un stage de 2 mois quasiment tous frais payés dans ce studio. J’ai eu la chance d’être sélectionnée. Digital Frontier déplorait que, malgré ces conditions, aucun élève ne poursuivait l’expérience plus loin en tant que salarié. Le fait que je parle Japonais a certainement facilité les choses pour mon embauche. Ils ont voulu m’engager immédiatement après mon stage mais j’ai d’abord fini mon diplôme et suis revenue en 2017.
Ils m’ont aidée pour mon installation à Tokyo car cela peut être un peu anxiogène d’être livré·e à soi-même dans cette grande ville où tout fonctionne différemment. C’est grâce à eux et à la confiance qu’ils m’ont donné que tout a commencé pour moi. Et je leur en suis très reconnaissante.
Pourquoi le Japon ? Parce que j’avais envie de redécouvrir mon pays, de reconnecter avec ma famille japonaise et de m’immerger en tant qu’adulte dans une entreprise japonaise. C’était plus un choix personnel qu’un attrait vers la culture populaire comme les mangas, ou en rapport à mon travail dans l’animation.
Claire:
J’ai fait mes études secondaires à Blois dans le Loir-et-Cher.
Après quelques mois d’études de musique et musicologie à l’université à Tours, j’ai cherché des écoles d’art.
Mais les écoles d’art que je connaissais étaient très chères et j’ai cherché une formation publique dans laquelle je pourrais pratiquer le dessin. Un ami faisait un DUT, appelé à l’époque “Services et Réseaux de communication”, qui maintenant s’appelle “métiers du multimédia et de l’internet”. Il m’a dit “tu verras c’est cool, on fait du Photoshop et du web design”. J’ai suivi cette formation, c’était intéressant. Ensuite, j’ai cherché un stage en jeu vidéo mais je me suis retrouvée dans une société à Paris qui faisait du jeu web, une sorte de start-up bizarre. C’était rigolo. J’ai été graphiste en alternance mais la société s’est cassée la figure durant mon contrat. Cette première expérience m’a permis de travailler dans une autre société de jeux vidéo. C’était très bien mais je ne pouvais prétendre qu’à des postes de graphisme de type interface par exemple, car d’autres personnes formées au dessin étaient, eux, de « vrais » illustrateurs.
Afin d’évoluer vers un travail plus créatif, je devais me former dans une école reconnue par les professionnels.
C’est à ce moment-là que j’ai préparé le concours des Gobelins pour la première fois (je l’ai réussi après trois tentatives). Et là, cela a été la révélation : c’était ce que je voulais faire de ma vie. Être enfermée dans une pièce pendant 7h avec des personnes qui pensent que le dessin c’est important. Ça fait rêver (rires).
J’ai également appris, à ce moment-là, que les prêts étudiants existaient. Alléluia ! J’ai fait des petits boulots pendant 1 an puis j’ai repassé le concours des Gobelins une deuxième fois. Je ne l’ai pas eu et j’ai compris que si je ne faisais pas que du dessin pendant 1 an, je n’aurais jamais ce concours. Mais je n’avais pas les moyens de payer une prépa artistique, donc avec les économies faites depuis mes 18 ans et en travaillant tous les étés, j’ai pu financer des cours équivalents à une prépa “faite maison”. J’ai pris des cours du soir, je me suis inscrite à la Sorbonne pour prendre des cours d’histoire de l’art, je me suis inscrite dans des petites associations pas chères etc… J’ai aussi eu la chance de rencontrer la personne avec qui je partage ma vie aujourd’hui ; en plus de son aide précieuse, ses parents étaient tous les deux artistes ; ils m’ont donné des cours de peinture, de sculpture. C’était un soutien très fort. Au final, ça m’a couté 4 ou 5 fois moins cher que si j’avais payé une prépa dans le privé. Et cette année-là, j’ai eu le concours !

Pour ce qui est du Japon, j’ai toujours été très fan de mangas et d’animés japonais mais je ne pensais pas du tout partir y travailler. Je n’imaginais même pas que c’était possible. J’ai rencontré des étudiants à Gobelins qui y avaient fait des stages, notamment Ines Scheiber, qui m’a aidée pour obtenir mon stage de 3e année chez Yapiko à Tokyo. Ça s’était très bien passé, j’avais des étoiles plein les yeux. Je me disais que le Japon, c’est vraiment bien mais que je reviendrai dans 10 ans car les animateurs ne sont pas assez payés et que je devais rembourser le prêt étudiant de mes 4 années d’études à Gobelins. En 2019, alors que je finissais ma dernière année, Netflix Tokyo a proposé un partenariat à l’école des Gobelins pour un “Post-Graduate Fellowship”. C’est-à-dire un contrat de travail pour un premier emploi-tremplin d’une durée d’1 an après la sortie de l’école. Plus clairement, Netflix Tokyo sélectionne un diplômé des Gobelins pour travailler avec leurs équipes pour un salaire convenable pendant un an. Pendant cette année, Netflix lui assigne des missions en interne mais aussi au sein d’autres studios japonais partenaires. Je suis allée dans 7 studios différents sur un an, en plus de mon travail chez Netflix.

Ivy: Comment sont organisés les studios d’animation japonais ? Y-a-t-il des différences au niveau de la hiérarchie par exemple ?
Claire :
Oui, il y a de grandes différences au niveau de la hiérarchie et du parcours professionnel. Au Japon, il y a une sorte de parcours plus ou moins obligatoire. Il faut gravir les échelons un par un. En gros, tu entres en étant douga artist (se prononce “doga”), c’est à dire que tu ne fais que du cleanup et de l’intervallage pendant un an ou deux, selon ton profil. Ensuite, si tu fais du bon travail, tu passes animateur·rice pendant quelques années. Puis, tu deviens superviseur·euse en animation. Et après ces années d’expériences, il sera possible de devenir designer puis directeur·rice artistique ou storyboarder. Et tu ne peux pas devenir storyboarder sans être réalisateur·rice. Sachant qu’au Japon, on est généralement le·la réalisateur·rice d’un seul épisode avant de l’être sur toute la série.
Michiru :
En France, on fait des études et ensuite, on se fait engager en tant qu’animateur ou designer. Au Japon, effectivement, ce système se rapprocherait plus des ateliers de peintres à la Renaissance où l’on commence vraiment grouillot et il est très difficile de vivre de son salaire. Mais disons que ce sont des études qu’on ne paye pas car on est censé apprendre sur le tas en mettant les mains dans le cambouis. Donc, c’est une approche qui est complètement différente. Au Japon, on dit souvent que pour apprendre, il faut répéter.
Ivy : Est-ce que vous avez pu échapper à ces étapes ?
Michiru :
Oui, on peut dire que je les ai court-circuitées mais c’est peut-être parce que j’avais accès à des postes de création concept et design. Ça aurait été certainement très différent si j’avais prétendu faire de l’animation pour le Japon. Actuellement, j’en fais mais pas pour le Japon. D’abord parce que je ne souhaite pas travailler avec les tarifs pratiqués au Japon mais aussi parce que n’ayant jamais fait de douga, j’ai des lacunes, notamment pour la communication avec les assistants que je ne rencontrerais jamais physiquement. Il y a un tas d’inscriptions à connaître et à annoter précisément sur chaque dessin. Et même si je suis maintenant une animatrice expérimentée, au sein d’une équipe japonaise, je serais un poids.

Il est vrai que maintenant le système est plus facile à pénétrer, mais c’est dû à une pénurie d’animateurs; plus personne ne veut faire ce métier aux conditions extrêmement difficiles au Japon. Il y a aussi beaucoup d’animateur·rice·s qui ne peuvent pas évoluer à un niveau supérieur car leur progression dépend des besoins du studio. Il y a une pénurie de bons dougas formés et opérationnels. Donc si ces dougas n’expriment pas clairement leur volonté d’évolution, on aura tendance à les maintenir dans cette position.


Michiru Baudet – travaux personnels
Claire :
Je pense que ça dépend aussi du contexte dans lequel tu arrives. A chaque fois que je suis arrivée dans un studio, ma première mission était de m’occuper du personnage qu’on voit à l’arrière-plan pendant 2 secondes d’un demi-plan d’un épisode que personne ne va regarder (rires). Et une fois qu’ils voient la qualité du travail fourni, ils te récupèrent pour te donner pas mal de travail parce qu’ils n’ont pas assez d’employés. J’ai donc pu accéder assez rapidement à des choses plus intéressantes.
Cela ne se passe pas comme ça normalement ; cela tient certainement au fait que ce soit Netflix qui m’ait envoyée. Les studios voulaient probablement entretenir les meilleures relations possibles avec Netflix.
Si j’étais arrivée en tant que freelance directement avec mon book, les choses auraient sans doute été différentes.
Ivy : Alors si l’on veut travailler au Japon, comment faire pour évoluer dans son travail ?
Michiru :
Quand tu débarques au Japon, tu butes sur des pratiques et des modes de communication différents. Le mieux est de se renseigner un maximum avant de partir.
Il y a des aspects assez immuables, comme le respect de la hiérarchie. Il y a un temps et une manière de faire les choses, chaque personne a sa place. Quand on a fait des études, on croit, à tort ou à raison, qu’on a le niveau pour brûler les étapes, ça peut être assez frustrant, voire stressant financièrement si votre salaire est bas dans une ville aussi chère que Tokyo. Il faut s’armer de patience mais, par exemple, l’un des moyens de progresser est de montrer son implication par des heures supplémentaires et de la communication régulière avec les supérieur.e.s, les réalisateur·rice·s. Autrement, tu peux rester bloqué à un palier, même si tu as un bon niveau. Avoir quelqu’un au début, pour te guider est l’idéal.
Claire :
Je dirais même que c’est uniquement si quelqu’un te prend par la main pour t’expliquer le fonctionnement que ça peut marcher, car il y a très peu de communication entre les gens et peu de personnes parlent anglais. Dans les studios où j’allais, ils me mettaient à côté du seul étranger du studio. Chez David Production, par exemple, je faisais des réunions avec le réalisateur, le responsable de la gestion de production, et un animateur qui était Colombien, qui parlait un japonais un peu approximatif, et qui traduisait en anglais, pour une Française ! Cela a généré des quiproquos amusants, mais globalement ça a super bien marché et nous sommes d’ailleurs toujours en contact. Aujourd’hui, j’apprends le japonais.
Ivy : Et toi Michiru, est-ce que tu parles japonais couramment ?
Michiru :
C’est ma langue maternelle mais à défaut de l’avoir pratiquée j’ai dû la réapprendre en arrivant au Japon. Cela a quand même été un énorme effort et ça reste très laborieux de lire et encore plus d’écrire. Il y a des postes que j’aurais bien voulu essayer mais même si les studios étaient suffisamment confiants pour me les confier, c’était impossible. Par exemple, le storyboard où l’on est censé faire des annotations écrites et surtout pouvoir lire un script. Même à l’oral, j’ai des limites. Je suis très souvent allée à des réunions avec des patrons d’autres studios ou des clients mais il était convenu que je ne prenne pas la parole parce que je ne maîtrisais pas le keigo, c’est-à-dire le japonais extrêmement poli. Et j’aurais mis tout le monde mal à l’aise si j’avais commencé à m’exprimer avec le client comme avec ma grand-mère (rires). Pour un Français qui débarque au Japon dans l’idée d’y travailler, il est nécessaire de parler japonais. Claire a été acceptée grâce à quelqu’un qui pouvait tout traduire, ce qui est quand même assez rare.
Claire :
Oui, j’ai eu beaucoup beaucoup de chance.
Michiru :
Et même si un·e français·e qui parle parfaitement japonais était embauché·e dans un studio japonais, il y aurait quand même des “clash culturels”. Il y a pas mal de détails qui peuvent sembler anodins quand on les regarde de façon isolée mais qui cumulés demandent un réel effort d’adaptation: ça va du sens des tableaux Excel à la façon appropriée de communiquer avec ses collègues. Le « bon sens » est très dépendant de la culture. Il n’est pas forcément le même pour un·e japonais·e ou un·e français·e.
Je ne pense pas que l’un ait plus raison que l’autre. Parfois, cela crée des situations assez rigolotes. Heureusement, les gens voient bien qu’on est étrangères ; ils ne s’attendent donc pas à ce qu’on réfléchisse complètement comme eux.

extrait de « Maman, il pleut des cordes » de Hugo de Faucompret, produit par Laidakfilm

Ivy : Connaissez-vous beaucoup d’autres expatrié·e·s dans le milieu de l’animation ? Est-ce qu’il y a plus de femmes ou d’hommes ? À quels postes ?
Claire :
Oui, nous avons des cercles. Pour la parité, je dirais moitié-moitié. Et après en ce qui concerne les postes …
Michiru :
Je pense que oui, effectivement, les leads animateurs sont des hommes.
Claire :
Oui, si c’est ça la question (rires).
Michiru :
Il faut dire qu’il y a beaucoup de turn-over. Ces hommes qui sont leads sont là depuis très longtemps. Concernant les filles qui travaillent dans l’animation au Japon depuis longtemps, il n’y en a que deux en fait…
Ivy : D’après vous, est-ce parce que les hommes ont plus d’opportunités d’évolution que les femmes ou y a-t-il d’autres raisons ?
Michiru :
Il est important de voir la façon dont les personnes intègrent les projets. J’ai remarqué du côté des hommes que les nouveaux arrivants arrivaient souvent « groupés ». Ils gravitent autour d’un projet ou d’une équipe déjà existante dans laquelle ils vont évoluer. Ce sont souvent des partenaires d’école qui viennent ensemble et se serrent les coudes. Alors que les filles font plus souvent cavalière seule et ont une expérience d’immersion totale.
Mais, les choses évoluent. Aujourd’hui, il y aurait tout à fait possibilité pour une fille de venir « en bande », mixte ou non mixte. Ce dont je parle correspond à une époque où même aux Gobelins, la parité n’était pas respectée.
J’ai observé une autre différence entre les hommes et les femmes expatrié·e·s (bien sûr, il s’agit de mes observations personnelles, pas forcément de la réalité) : lorsqu’un français célibataire arrive au Japon, c’est relativement facile pour lui de se mettre en couple avec une japonaise. A l’inverse, il semble plus compliqué pour une française de se mettre en couple avec un japonais. En tant que fille, j’ai dû renoncer à plusieurs relations amoureuses avec des Japonais. Je ne me sentais pas d’endosser le rôle et le statut que l’on m’aurait donné au Japon si j’avais voulu faire évoluer l’histoire vers quelque chose de plus sérieux. Arrivées à un certain âge, beaucoup de filles ont envie d’avoir une vie familiale et repartent en France.
Ivy : Donc c’est plus simple pour un homme d’être expatrié car on ne lui demande pas les mêmes efforts ?
Michiru :
Dans un contexte de couple, de mariage, j’ai le sentiment que l’effort d’adaptation est bien plus conséquent pour une femme. Ce que je vais dire peut paraitre hyper vieux jeu, mais je crains que ce ne soit encore vrai : c’est sur les épaules de la femme que repose l’éducation des enfants qui est garante, mine de rien, de la respectabilité du foyer. C’est beaucoup de pression pour une expatriée qui débarque. Sans en être la raison principale, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais rentrer en France. Que sentimentalement lorsque j’arrive à un stade sérieux, j’abandonne. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber amoureuse d’un japonais, ça n’a rien à voir. Mais je ne me sentirais pas de créer un réseau entre voisines, entre mères au foyer, pour que mon enfant aille dans la bonne école, ce genre de chose. Mais peut-être est-ce simplement moi qui me met trop de pression.
Ivy : Et si l’on imagine la situation pour quelqu’un qui ne veut pas se marier et/ou pas d’enfants ?
Michiru :
On est obligé d’y penser. Lorsque j’étais encore employée dans une société, la deuxième question que l’on me posait après “quel est votre prénom ?”, c’était “est-ce que vous êtes mariée ?” Il fallait immédiatement le savoir pour me mettre dans une case mais aussi parce que les autres célibataires cherchent à se marier. C’est une question qui est redondante et à laquelle j’ai dû réfléchir.
Claire :
Moi, ça m’a tranquillisée d’être déjà mariée quand je suis arrivée, pour plusieurs raisons. Par exemple, quand Netflix me présentait aux autres studios, le fait que je sois mariée était presque toujours évoqué. Sous-entendu : je dois faire un travail et en plus, je dois m’occuper de mon pauvre mari qui ne sait forcément rien faire de ses dix doigts (rires), vous comprendrez donc que je ne puisse pas faire d’heures supplémentaires. Mais ça me donnait une bonne excuse. Il me suffisait de dire “excusez-moi, j’ai une vie de famille”… Le fait d’être sous contrat avec Netflix me protégeait aussi.
Dans les studios japonais où j’ai travaillé, l’intégralité des décisionnaires – leads, producteurs, réal etc – étaient des hommes – en tout cas dans les équipes où j’ai pu intervenir. Je me souviens d’un studio où à chaque réunion, la seule autre femme que moi était une japonaise qui nous servait le café. Je ne pouvais pas me fondre complètement dans le moule mais au moins je répondais au critère social « femme de plus de 25 ans = femme mariée »… c’était déjà ça !
Michiru :
C’est ça, pour moi aussi, c’est la même expérience.
Claire:
Un autre exemple: quand tu es à un meeting où tout le monde est assis sur des tatamis sur des petits coussins et que tu te tiens droite en te disant “je suis une femme designer, et je suis digne” mais qu’au bout de 5 minutes, tu t’écroules parce que tu as mal aux jambes… Ce n’est pas l’attitude corporelle attendue dans une réunion ; il faut se tenir droite, avec les jambes dans une certaine posture. Donc, j’ai pris mon parti de n’en avoir rien à faire car je n’avais pas le choix. Au moins, le respect que j’ai gagné est uniquement dû à mon travail. Je pense que si j’avais été un homme, je me serais comportée de la même manière, mais je ne l’aurais juste pas relevé. Alors qu’en étant une femme, je me comporte comme j’ai envie de me comporter parce que c’est comme ça, mais je sais que si je faisais autrement, ce serait quand même mieux perçu.
Michiru :
Mon expérience est assez opposée à celle de Claire car, contrairement à elle, j’ai fortement essayé de me conformer. En tant que franco-japonaise, j’avais le sentiment d’avoir des choses à prouver. J’ai donc adapté ma manière de m’habiller et de me comporter. C’est vrai que cela m’a évité un certain nombre de problèmes mais il y en a certains autres que je n’ai pas pu éviter. J’arrivais encore moins à dire non qu’avant et j’essayais toujours de mettre mon interlocuteur à l’aise, encore plus si c’était un supérieur. Cela a amené des situations de drague au travail et je n’avais pas les outils pour désamorcer la situation. J’étais tellement dans l’idée de ne pas faire de vagues. Et un jour, en appelant ma petite sœur, elle m’a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi je me mettais des œillères. « ce n’est pas possible ce qui t’arrive et tout ce que tu acceptes ». Après ça, je suis revenue au bureau et j’ai tapé du poing sur la table en disant que je ne voulais pas mélanger le personnel et le professionnel. C’est à ce moment-là que j’ai décidé qu’en tant que franco-japonaise, j’avais moi aussi le droit de sortir ma « gaijin card » (gaijin = étranger.e) concernant le comportement et que désormais, j’étais japonaise quand ça m’arrange et française quand ça m’arrange. Cela concerne les heures supplémentaires notamment.
Claire :
Finalement, peu importe le point de perfection auquel tu arrives, tu ne seras jamais japonais·e. Pour toi Michiru, ça a dû être très spécial du fait de ta double nationalité. Lorsqu’on n’est pas du tout japonais, on comprend que, même en faisant beaucoup d’efforts, au final, ça ne sera pas récompensé. Donc la seule voie viable, c’est d’assumer ce qu’on est : une étrangère qui travaille au Japon et, en tant qu’étrangère qui travaille au Japon, je veux être traitée de telle et telle manière. Cela met des limites claires et depuis que j’ai fait ça, je me sens mieux. Mais il y a un pendant négatif… On prend beaucoup de distance par rapport à tout, à l’expérience de vie sur place en générale. Cela n’enlève rien au fait que le Japon a produit une grande partie des œuvres qui m’ont le plus touchée et qui ont fait ce que je suis aujourd’hui. Ce n’est pas forcément évident à accepter, c’est un petit peu comme les 5 étapes du deuil (rires). Mais pour toi, Michiru, ça doit être un effort personnel incroyable du fait de ton histoire personnelle.

Michiru:
Oui, ça a été un travail sur moi qui n’a pas été facile tous les jours. Quelques désillusions et frustrations mais aussi, beaucoup de compréhension et de résilience. Finalement, je me suis réconciliée avec beaucoup de choses que je comprends mieux maintenant.
Claire :
Pour conclure, je ne me revendique pas spécialement féministe mais j’avoue que depuis que je suis au Japon, cela devient de plus en plus difficile de ne pas se « radicaliser » (rires). Ce n’est pas parce qu’ils agressent des femmes ou que sais-je, mais c’est plus à cause d’un état de fait, d’un fonctionnement sociétal de base, considéré ici comme la norme alors qu’à mes yeux, c’est vraiment sexiste. Et pour que moi je considère quelque chose comme sexiste, il faut y aller.
Michiru :
Pour finir, j’aimerais ajouter que concernant les situations de sexisme qui me sont arrivées, la moitié sont arrivées avec des collègues français. Ce n’est donc pas inhérent au Japon.
Ivy : Quel poste exercez-vous aujourd’hui ?
Michiru:
J’étais concept artist à Digital Frontier et, ensuite, j’ai été character designer à Square Enix. Je suis maintenant animatrice clé en free-lance et parfois character designer. On peut dire que je suis une sorte de mercenaire volante. Je ne suis attachée à aucun studio en particulier. Maintenant que ma carrière est lancée, on vient me chercher pour des missions plus ou moins courtes. Selon le salaire, l’intérêt artistique ou narratif, j’accepte ou je refuse. Beaucoup de gens craignent « l’instabilité » de ce mode de vie. Mais j’ai maintenant la chance d’avoir un carnet d’adresses assez solide. Je refuse du travail faute de disponibilités bien plus souvent que je n’en recherche. Je touche du bois !
Claire :
Aujourd’hui, je suis Production and Artistic Supervisor à Netflix Tokyo et, avant, j’étais animatrice en free-lance. Durant cette première année où j’ai travaillé chez Netflix et dans d’autres studios, j’ai fait des missions courtes. J’ai fait du design (personnages / décors / props / véhicules) chez David Production sur Spriggan, de l’animation clé chez Mappa, et du concept art chez Khara, Sublimation et Studio WIT. J’ai aussi été décoratrice couleur chez Production I.G. sur B The Beginning saison 2. Chez No Border, j’ai fait du design de props et de décor pour le jeu vidéo Koomos. En gros, j’ai fait de tout sauf du storyboard et de la postproduction, pendant un an. Je faisais également du développement visuel général chez Netflix. J’ai été mise assez tôt sur un projet encore confidentiel sur lequel je travaille actuellement et qui prend forme (aujourd’hui la Netflix Anime Creators Base, ouverte officiellement en Septembre 2021).

Ivy : Quels sont vos objectifs et projets professionnels pour les années à venir ?
Michiru :
Je n’ai pas d’objectif précis actuellement. Pour des raisons personnelles, je vais rentrer en France. J’aime faire des choses nouvelles et découvrir. Ce sera peut-être prendre de nouveaux postes et diriger des équipes par exemple. Cela m’intéresse vraiment de voir comment les deux pays fonctionnent. Pour l’instant, Je comprends davantage le mode de travail japonais que le mode de travail français.
Claire :
En travaillant au sein des studios, je me rends compte que l’animation japonaise n’est pas exactement telle que les Français l’imaginent.
C’est différent de venir pour un stage très court, sans connaître le pays ni l’industrie avec des paillettes dans les yeux, que d’appréhender la réalité. Grâce à Netflix, j’ai eu une vision plus globale de cette l’industrie et j’ai compris que ça ne correspondait pas au fantasme que j’en avais avant de partir. Ce qui est normal au final.
Mes plans ont complètement changé. La façon dont je vois le travail, ce que j’avais envie de faire et la façon dont j’avais envie de le faire. Quand je suis rentrée aux Gobelins, je voulais faire de l’animation. Lorsque je suis sortie des Gobelins, je voulais faire de la réalisation. Et maintenant, je veux faire de la production. C’est une manière très simplifiée de le dire mais en gros, c’est ça. Par la suite, j’aimerais vraiment trouver un poste aux États-Unis. Les 3 plus gros producteurs d’animation sont la France, le Japon et les États-Unis. J’ai envie d’apprendre comment les trois fonctionnent car ils fonctionnent de manière complètement différente. A terme, j’ai envie de créer ma propre société. Je veux faire des films qui me semblent justes et nécessaires. En tant que productrice, j’ai envie de pouvoir donner leur chance à de jeunes réalisateur·rice·s qui n’ont pas encore pu faire leurs preuves, ou à des projets qui n’ont pas la chance d’avoir de grands noms bankables attachés à leur dossier. Pour faire simple, j’ai envie de pouvoir prendre des risques.


Depuis cet entretien, Claire Matz et Michiru Baudet sont rentrées en France pour se lancer dans de nouveaux projets.
Claire a créé sa société de production et services en entertainment.
Vous pouvez faire un tour sur son site : https://www.yabunousagi.com et sur instagram @_yabunousagi_
Quant à Michiru, elle a travaillé sur la série Netflix Arcane chez Fortiche Prod et pour des films publicitaires en France et en Angleterre. Elle s’apprête à rempiler avec enthousiasme pour la saison 2 d’Arcane.
Pour voir son travail, rdv sur instagram @michirubaudet et pour son témoignage en BD de son expérience de jeune femme franco-japonaise c’est @KinakoMichiru