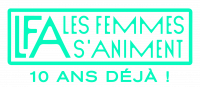D’Annecy à Cannes, Cabourg, et Angoulême où elles ont été distinguées, jusqu’aux salles de cinéma parisiennes depuis le 4 septembre, on pourra dire qu’elles en auront fait du chemin, Les Hirondelles de Kaboul. Et ce n’est pas terminé. J’ai eu la chance de m’entretenir avec Eléa Gobbé-Mévellec, qui a coréalisé avec Zabou Breitman cette adaptation toute en finesse du roman de Yasmina Khadra.

Au début de cet échange, Eléa me confie que, depuis toute petite, elle aime la peinture et le dessin. C’est d’ailleurs une institutrice de maternelle qui, la première, lui a insufflé la confiance de poursuivre dans cette voie. A la petite Eléa, alors âgée de 4 ans, cette dernière désigne un tableau de Gauguin : « tu vois, ce que tu fais là, c’est des dessins, le gars il fait comme toi ». Sans savoir qu’avec cette phrase, elle lui ouvrait le champ des tous les possibles. Le sourire aux lèvres, l’Eléa du présent confie que faire des films permet aussi de se rappeler ce qu’on était avant.
Lorsque je l’interroge au sujet de ses influences, elle me parle de peinture impressionniste, des mangas, d’Hugo Pratt, de Wong Kar Wai à cette époque. Du « graphisme tellement fort, tellement beau qui est celui de Nicolas de Crécy », de Frederik Peeters en BD, de Lorenzo Mattotti, mais surtout du film révélation que fut pour elle « Les Triplettes de Belleville ».
Vient ensuite la question de son parcours. Son entrée à l’école il y a 15 ans, en 2003. Après un bac en arts appliqués, sa formation aux Gobelins. Et, après sa sortie de l’école en 2006, les projets qui se succèdent. Elle parle de son premier court-métrage (Escale). Du trait personnel qu’elle s’est forgée par le biais de divers travaux de graphisme pour de l’habillage tv, des publicités de luxe ou autres marques. De son travail sur des longs-métrages tels que Le chat du rabbin, Le jour des corneilles, Ernest et Célestine, Avril ou le monde truqué, Le prophète (en tant que story boardeuse), Last man (en tant que designeuse secondaire). Toutes ces expériences lui ont, m’explique-t-elle, appris à se forger une expérience solide pour la suite.
En parallèle d’Ernest et Célestine, Eléa commence à développer un projet personnel de long-métrage. Didier Brunner, directeur des Armateurs à l’époque, remarque son travail et lui propose de coréaliser Les Hirondelles de Kaboul avec Zabou Breitman. Elle qui tente de développer un univers plus personnel se montre au début hésitante. Et puis, en lisant le livre et le script, elle est happée par l’histoire. Eléa songe très vite à l’aquarelle, utilisée sur Ernest et Célestine, pour dessiner cette histoire. Elle est confortée dans son désir parce que les contrastes de cette ville incroyable s’y prêtent, entre lumière franche et ombres très marquées. Toute une mise en scène s’inscrit dans son esprit à travers cette histoire, et par l’intériorité des personnages.

Et puis, comment résister à la perspective d’apprendre de Zabou Breitman ? A l’attrait d’une alliance entre prises de vues réelles dont Zabou a l’expérience, et l’animation maîtrisée par Eléa ? D’un tout qui permettrait d’apporter à la fois réalisme et distanciation via le dessin. Avec le sentiment immédiat qu’elles voulaient faire le même film, est venue la confiance. Elles ont commencé par un pilote de deux minutes, échantillon du film où elles ont pu mettre en place la technique qu’elles désiraient, poser des intentions, et démarrer un boulot de recherche afin de savoir comment aborder l’histoire. Après deux ans de recherches et de financement, a débuté la production. La répartition des tâches s’est faite naturellement avec Zabou, du fait de leurs expériences réciproques. Il faisait sens que cette dernière réécrive le scénario et dirige les acteurs, tandis qu’Eléa devait développer les éléments graphiques et diriger l’équipe technique des dessinateurs, etc… et si, durant leur collaboration, les mots qu’elles employaient n’étaient pas forcément les mêmes, il leur arrivait de communiquer par dessins.
Parmi les choses qu’Eléa raconte avoir apprises de Zabou, elle évoque la déconstruction des méthodes d’animation traditionnelles des longs métrages auxquelles Eléa est coutumière. Par exemple, sa façon d’aborder le jeu d’acteur. Zabou avait à cœur qu’ils tournent dans les conditions réelles de l’histoire. Ainsi, les acteurs ont joué et ont été filmés évoluant dans des espaces qu’elles avaient ensemble prédéfinis, habillés de costumes qu’Eléa leur avait choisis dans le design des personnages. Eléa et Zabou ont pris le son à la perche afin de restituer ces détails, cet aspect réel dans le jeu qu’elles n’auraient pas obtenu en enregistrant les voix à la barre. Elles s’étaient procuré des burkas que les comédiennes ont revêtues (ainsi que le comédien). Ce son réaliste des paroles derrière un voile, le souffle coupé, couplé à la distance du dessin, a apporté un aspect très particulier aux scènes. Zabou a également donné toute latitude aux acteurs d’improviser, et de composer leurs personnages, à travers les accessoires qu’elles leur avaient remis. « Zabou m’a montré qu’il était toujours possible, qu’il était important d’aller plus loin, qu’il fallait prendre le risque d’essayer, de sortir des sentiers battus, de reconsidérer et de remettre en question ses premières idées. Qu’ainsi venaient des éléments nouveaux qu’il était parfois difficile de voir seul. »
Nous évoquons ensuite la ville de Kaboul, véritable personnage de cette histoire. Eléa parle des informations qui pullulent à cause du conflit qui y perdure, du choix assumé qu’elle a fait avec Zabou de ne pas s’y rendre. « Dans le travail déjà digéré des reporters et des photographes, il y avait déjà une distance avec le réel. Il nous importait qu’elle existe, déjà parce qu’elle était géographique et puis par rapport à ce processus du réel à ne pas déformer. Il y avait ce filtre qui était précieux pour ne pas tout dire, et aussi parce que c’est une fiction. On ne raconte pas le conflit en soi, mais une histoire. C’était mieux de ne pas aller trop près des choses. » Et, de fait, les reportages et les photos semblent attiser l’imagination d’Eléa vis-à-vis de Kaboul. Elle parle de la lumière frappante d’une ville complètement déconstruite « entre ruines de bâtiments moitié soviétiques, moitié orientaux mais surtout soviétique. D’une ville aussi contemporaine que parce que subissant le régime des talibans, dans laquelle des panneaux avec des logos publicitaires truffés de balle avoisinent des charrettes qui passent sur la route avec des Toyota ». « Des bouts de béton des années 70 qui sont complètement explosés avec des fils de fer qui sortent de tout ça ».

Elle les convoque devant mes yeux, ces incroyables images. En évoquant « ces éléments de modernité, de Moyen Âge, de vie de mort qui se mélangent au milieu de la lumière et de la poussière sur une ville dans des volumes complètement improbables de milliards de maisons à perte de vue au milieu des montagnes avec la neige dans les cimes ». « Cette beauté et cette horreur qui se côtoient au milieu de tout ça », il me semble soudain qu’à travers les yeux d’Eléa, je les vois.
Eléa explique que la corrélation du visuel déjà présent et de l’histoire lui a donné le sens de le réaliser en animation, avec cette approche documentariste de reportage amené par Zabou. C’est naturellement qu’est venu se poser le dessin, en carnet de croquis. Pas assez précis pour déformer la réalité, pas trop détaillé pour créer de la distance, et permettre aussi au spectateur de recréer l’émotion qui lui est propre. Ainsi, Eléa et Zabou espéraient éviter de prétendre à une histoire « qui n’était pas la leur » et adapter la fiction du roman de Yasmina Khadra, au sein duquel primaient l’histoire et les personnages. « Il ne s’agissait pas d’une histoire politique, mais d’une histoire humaine dans un contexte politique ».
En évoquant la question de l’adaptation, Eléa explique qu’il existait un scénario d’origine écrit par Patricia Mortagne et Sébastien Tavel, adaptation du roman. Zabou a réécrit le scénario pour y renforcer le point de vue de la résistance véhiculée par Zunaïra et Mussarat. Il était important pour elle que cette idée de vie prenne le pas sur le constat de la souffrance de ces personnages opprimés. Dans cette optique, Zabou a fait du personnage de Zunaïra une dessinatrice. Pour elle, il s’agissait d’un acte politique et d’un vrai pied de nez, ce personnage de femme qui dessine malgré les interdits de l’époque. Si l’auteur du livre d’origine, Yasmina Khadra, n’était pas toujours en accord avec toutes leurs idées, il les a toujours respectées. « Il était très heureux que quelqu’un s’empare de son histoire, que s’effectue une sorte de passation de relai. »
En se documentant sur leur sujet, les réalisatrices ont découvert l’existence de classes secrètes où des instructeurs éduquaient les petites filles. Eléa évoque un clip Burka Blue, mettant en scène un groupe de punk garage constitué de jeunes femmes afghanes (Burka Band) qui jouent et chantent, vêtues d’une burka. Elles se filment dans Kaboul en dessous du chadri. C’est cette image très forte qui insuffle aux réalisatrices l’idée des cadrages en point de vue subjectif de l’intérieur du chadri de Zunaira ou de Mussarat. Pour Eléa, la leçon est là. « Dans ces femmes opprimées, et du sursaut de résistance et de vie que leur situation a généré en elles. »
Lorsque je la questionne au sujet de ce qui la touche le plus dans les histoires, elle me répond que c’est la manière dont, en les digérant, elles nous font évoluer. Comment apprendre au travers des histoires d’autres, confronter son vécu au leur, pour pouvoir avancer. S’imprégner d’images qui ne sont pas les siennes, afin d’avoir une vision différente d’une thématique qui peut la traverser. Elle aime finalement aller voir ailleurs si elle s’y retrouve un peu. Et, de la même manière qu’elle reçoit cette opulence visuelle et sonore, elle éprouve le désir à son tour, à travers sa propre vision, de permettre aux gens qui regarderont ses films de vivre le même processus.
Eléa aime transfigurer le réel grâce au dessin afin de nous inciter à le regarder d’une autre manière. Pour elle, l’animation se réinvente à chaque film. « On utilise des bases qui ont été développées dans les productions d’avant mais qui doivent trouver leur caractère par rapport à cette nouvelle histoire qu’on raconte. » Pour elle, ce qui fait le caractère de la production française, c’est sa diversité, cette recherche sans cesse renouvelée d’un graphisme différent, là où dans d’autres continents l’animation semble plus homogénéisée, les techniques et les traits plus récurrents. « J ‘ai l’impression qu’en France, c’est plus difficile de rassembler tout le monde sous la même bannière, un style unique. »
Dans le travail d’équipe, elle croit très fort en la complémentarité. Et Les Hirondelles de Kaboul, fruit du travail d’une grosse centaine de personnes, n’y fait pas exception, riche en nouvelles rencontres, et parfois à des retrouvailles (avec d’anciens membres des équipes de Last Man et d’Ernest et Célestine…) Elle me dit d’ailleurs qu’un métier qui bouge sans cesse constitue pour elle paradoxalement un repère en soi. « Mon métier est tellement mouvant qu’il ressemble à ma vie. »
La question des femmes et de leur liberté constituant le cœur du film, je questionne Eléa sur la question du statut des femmes dans l’animation. Pour elle, être femme constitue un caractère, au même titre que d’être Bretonne, ou dessinatrice, autant de traits qui la caractérisent sans constituer un obstacle pour autant. Elle trouverait gênant de penser qu’on aurait pu leur demander de faire ce film parce que Zabou et elle sont des femmes, et non pour une question d’univers ou de sensibilité. Eléa se déclare chanceuse de ne pas avoir subi de discrimination sexiste, tout en déplorant que d’autres aient encore à en souffrir, en ayant un salaire inférieur aux hommes, ou un manque de reconnaissance de leur travail.

Elle déplore qu’il n’y ait pas davantage de femmes réalisatrices, ce qui l’a empêchée de se projeter plus tôt dans le métier. « C’est important de décloisonner et d’utiliser tous les moyens possibles pour que ce métier soit accessible à tous de manière égale et que les femmes puissent se donner la confiance de faire ce qu’elles ont à faire ». Eléa parle de la nécessité de faire davantage de place aux femmes, afin de trouver un équilibre, jusqu’à en arriver enfin au constat qu’« il y a pas de raison qu’on engage moins une femme qu’un homme pour faire un film ». Elle s’empresse de préciser ensuite « enfin, une femme autant au même titre que toutes les personnes qui souffrent des cases dans lesquelles on les enferme. Il faut parler de tout dans les films pour que tout le monde puisse évoluer au travers de ce qu’il est, simplement et que tout le monde puisse accepter ce qu’il est. C’est important qu’il y ait la place laissée à tout ça dans les films. »
Cependant, nous constatons ensemble qu’au cinéma comme dans l’animation, nous vivons une période charnière. « Tout commence à se décloisonner. De plus en plus de place est faite aux femmes et leur travail est mieux reconnu et accueilli ».
Juste avant de se quitter, pour conclure cet échange, tandis que je lui demande d’un ton léger si les dessinateurs rêvent en couleur, en 2d, ou en aquarelle, Eléa me répond, espiègle : « Je sais pas, mais ils rêvent en tout cas ! Beaucoup beaucoup. Moi oui je rêve en film, clairement. Y a des plans des cadrages, des zooms et tout est précis, les images, les couleurs. Je me demande vraiment comment les gens voient les trucs. Chez moi c’est clair, ça passe par l’image. Autant la mémoire, j’y arrive pas, je retiens pas les noms propres, alors que j’adore la musique, un son va me marquer beaucoup plus que le nom d’une musique par ex. La sonorité, mais pas le lettrage, l’image et pas le souvenir. »
Propos recueillis par Suaëna Airault, auteur-scénariste.