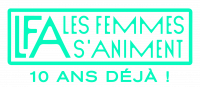© Christel Chabert – 2023
C’est à Valence, dans le studio de Parmi les lucioles, que je rencontre pour la première fois Bénédicte Galup. Je ne connais pas encore son travail, ni sa carrière, mais je suis d’emblée conquise par cette femme solaire, qui me présente son équipe avec autant d’enthousiasme, qu’elle me parle du film en cours – « Le grand voyage de Gouti » – avec passion. Ma curiosité étant aiguisée, rendez-vous est pris pour faire plus ample connaissance, autour d’un bon petit plat. Maintenant, imaginez la scène : sous un ciel azur balayé par le mistral, la terrasse bondée d’un restaurant du centre-ville de Valence ; là, sous une pergola, deux femmes – la cinquantaine – conversent avec animation et profusion de rires ; vous voilà maintenant prêt·e à découvrir celle que ses premiers collaborateurs ont d’emblée qualifié d’ « aventurière de l’animation ». « C’est vrai que je vis chaque production comme une aventure : ce sont de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, un nouvel univers graphique… Et pour aborder ce « Nouveau monde », j’embarque à bord du navire, avec mes valises, et je largue les amarres. Au début, je l’ai fait un peu par inconscience. Et puis le navire peut s’avérer être une galère ! (Elle rit) Mais très vite, j’ai compris que chaque nouvelle opportunité constitue une véritable chance.»
Si Paris est aujourd’hui son port d’attache, le cœur de Bénédicte bat pour Montpellier où elle découvre ce qui deviendra son futur métier. « C’est là que je suis entrée aux Beaux-Arts, après avoir obtenu un Bac D « Sciences de la nature ». Je ne me voyais pas devenir artiste, mais j’aime bricoler et tout ce qui est artistique. Dans les années 80, pendant mes premières années d’études, je me suis demandée où j’allais, et mes parents aussi, sans doute. Je ne me reconnaissais pas du tout dans le courant artistique du moment – le « Supports-Surfaces » – porté par mes professeurs : il fallait avoir un discours plus, qu’autre chose ; les œuvres – quelles qu’elles soient – n’avaient plus aucun message à délivrer par elle-même. Ça fait rire tout le monde quand je raconte que l’on suspendait trois petits trucs sur un mur, qu’on faisait une demi-heure de discours et que tout le monde faisait « Oh ! Ah ! ». (Elle rit.) Heureusement, il y avait une petite étoile qui veillait sur moi : alors que j’étais en fin d’études, deux techniciens de La Fabrique – la société de production de Jean-François Laguionie – sont venus animer un atelier aux Beaux-Arts. Ce réalisateur s’était installé, quelques années auparavant, dans le petit village de Saint-Laurent-le-Minier (30), pour créer La Fabrique, le studio dans lequel il a réalisé son premier long-métrage : « Gwen, le livre de sable ». De mon côté, j’avais acquis une première expérience dans l’animation, grâce à Pierre Azuelos, qui proposait des stages d’initiation dans les écoles et dans les MJC. Or, l’atelier de La Fabrique m’offrait la possibilité d’en savoir plus, avec la perspective de réaliser mon rêve, de mêler l’art et la technologie. Je précise qu’à l’époque, la technologie, c’était encore celle des caméras, des bancs-titres et de la pellicule. Or La Fabrique allait produire la série de Michel Ocelot en ombres chinoises : « Ciné-Si ». Elle avait besoin d’une « petite-main » pour faire un tas de choses et notamment pour préparer le travail des animateurs. »
Bénédicte débarque donc à Saint-Laurent-le-Minier, dans un ancien atelier de bobinage de fil de soie transformé en studio. « Il fallait être prête à vivre, dans ce village cévenol de 340 habitants… Et surtout dans ce fond de vallée ! C’était riant, l’été. Mais au cœur de l’hiver, le village n’a que trois heures de soleil par jour ! Pour y rester, comme disait Michel Ocelot, il fallait une grande vie intérieure. » (Elle rit.)
On est en 1988. Bénédicte a 24 ans. Dans cette « Fabrique », la jeune femme comprend très vite qu’elle a trouvé son futur métier. Elle ne sait pas encore qu’elle vient de rencontrer sa famille de cinéma. « L’animation, je l’ai apprise directement avec Michel Ocelot, dans l’esprit maître et apprentis : il y avait des choses à découper, des choses à peindre ; c’était minutieux et répétitif… Je me souviens que je faisais de la détection de voix sur une table 16mm, pendant des heures, parce que Michel est quelqu’un de très précis sur la détection ; il tient absolument à ce que images et sons coïncident exactement, pour que le spectateur puisse lire sur les lèvres du personnage. Techniquement, la production était encore assez traditionnelle – c’était du celluloïd et une caméra – même si le studio s’était équipé des tout premiers ordinateurs du genre. Pour « Ciné-Si », en l’occurrence, c’était du papier découpé, animé sous caméra. Alors, nous, les jeunes, on apprenait tout sur le tas. Très peu avaient fait une école. En dehors des Gobelins, il y avait peu de formations possibles. L’école, c’était là, à La Fabrique. Comme on y produisait tout sur place, il suffisait de monter d’un étage ou d’aller dans une autre pièce, pour voir une toute autre étape du travail. Aujourd’hui, dans les studios, c’est rarement le cas. Tout est compartimenté. On le voit avec le son, notamment : certains techniciens n’y ont accès que s’ils font un film eux-mêmes. Or le son, c’est vraiment un tiers du film ».
Jusqu’à cinquante personnes vont et viennent dans le studio cévenol, dont un bon nombre de femmes. « C’était aussi un univers où les femmes étaient les bienvenues. D’autant que Jean-François Laguionie avait un côté Pygmalion. Il en a notamment incité beaucoup à devenir réalisatrices ou scénaristes de films d’animation. Après quelques temps, il m’a dit : « La Fabrique est aussi là, pour toi ; il y a des tables, des crayons et du papier ; si tu as envie de dessiner et de faire un film, tu n’as qu’à t’installer ». Bien sûr, il disait la même chose aux hommes. Nombre de réalisateurs, réalisatrices et techniciens ont fait leurs armes dans ce studio. Mais cette attitude est d’autant plus remarquable, qu’à cette période, le monde du travail – et donc également celui du film d’animation – était encore très macho. Les « Animateurs avec un grand A » avaient fait de l’animation, la chasse gardée des hommes, les femmes n’étant bonnes qu’à faire de la trace et de la gouache. Et puis à La Fabrique, il n’y avait pas de métier plus noble qu’un autre car l’isolement du lieu rendait la polyvalence indispensable et obligatoire. Alors, non seulement c’était très formateur, mais ça t’apprenait à respecter tous les autres métiers parce que tu savais ce qu’il en coûte de faire telle ou telle chose ».

© La Fabrique – Bénédicte Galup – 2012
Pour Bénédicte, cette polyvalence est une chance, tout comme l’opportunité que lui a donnée ce studio, d’avoir accès aux tout premiers ordinateurs et logiciels d’animation (N.A.C., Atari, etc). « C’est ce qui m’a permis de faire 35 années de carrière et à des postes très différents. ». Mais ce côté touche-à-tout correspond aussi à son tempérament. « Dès que je sens que je suis en train de m’enfermer, il faut que je change. Chaque fois que j’ai senti qu’on me cataloguait dans un rôle, je suis partie vers une nouvelle aventure. Partie ailleurs, parfois dans d’autres pays pour apprendre de nouvelles choses, pour me confronter à d’autres caractères, à d’autres gens… C’est très enrichissant».
Quand Michel Ocelot l’appelle, en 1993, pour lui proposer de venir travailler sur Kirikou et la sorcière, Bénédicte a 29 ans ; elle sent qu’est venu le temps de quitter le giron de La Fabrique, ses collaborateurs – devenus des amis – et sa chère Occitanie. « J’étais quand même soufflée par la proposition de Michel. Et je me disais un peu que je quittais la proie pour l’ombre. Car Michel venait lui-même de traverser une période difficile. Mais c’était l’occasion de travailler avec lui, à nouveau, et sur un premier long-métrage. Il m’a donc envoyé le séquencier du film et ses premiers dessins. C’était déjà magnifique ! Et je me disais que ce serait une belle aventure. La suite me donnera raison ».
Bénédicte largue donc, pour la première fois, les amarres et pose ses valises à Angoulême où le producteur, Didier Brunner, installe la fabrication du film. « Il venait de créer Les Armateurs pour le produire. Il avait eu un véritable coup de foudre pour le projet ! ». Là, elle va diriger le compositing pendant les deux ans et demi que dure sa fabrication. Puis l’aventure, avec Les Armateurs, se poursuit à Paris, où elle occupe le poste d’assistante-réalisatrice sur la série Belphégor, créée par Gérald Dupeyrot et réalisée par Jean-Christophe Roger. « C’est là que je rencontre Frédéric Bézian, le directeur artistique, qui est aussi auteur de BD. On s’est tellement bien entendu, que quelques années plus tard, on a fait ensemble « La clé », un court-métrage de douze minutes pour TF1. Ça a été une expérience merveilleuse que j’aimerais renouveler. Il faut juste que je trouve la bonne idée ». Elle rit.

En 2001, Bénédicte part au Canada superviser le compositing des Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet. « On s’était connu à La Fabrique ». Au Québec, elle découvre un monde où la polyvalence n’est pas de mise : chaque technicien est assigné à une tâche précise, selon une méthode et des règles auxquelles il ne faut pas déroger. « J’en ai défrisé quelques-uns ! (Elle rit) Mais c’était passionnant. Et ça parlait dans toutes les langues. Il y avait beaucoup à faire… Il fallait sans cesse trouver des solutions, comme de dérégler le scanner qui lissait à la perfection les traits, alors que Sylvain voulait, au contraire, qu’on garde son aspect « crayonné ». Je me revois en train de changer la ligne de code, avec un ami informaticien français, au bout du fil. (Elle rit) Par contre, les productions de long-métrage sont si intenses et je m’y investis tellement, que derrière, j’ai besoin de faire des breaks qui peuvent durer un an, comme après ce film ».
Dans sa carrière, Bénédicte a toujours alterné les longs-métrages (Adama, le monde des souffles, Ernest et Célestine…) et les séries (Ciné-Si, Belphégor, « Tchoupi…), tantôt à la supervision du compositing, tantôt comme assistante de réalisation. « Le long-métrage, c’est une course de fond. Tandis que la série, ça s’apparente plutôt à un sprint. Ce qui me plaît sur la série, c’est la déclinaison d’un univers, des personnages… Sur le long métrage, il y a d’autres enjeux et le plaisir de découvrir un auteur ».

© Benedicte Galup – 2005
Sur un court, comme sur un long, Bénédicte se retrouve souvent à la tête d’équipes très majoritairement masculines, qu’elle doit diriger. « Être cheffe, ça n’a jamais été une fin en soi, mais il faut le faire. Alors j’assume. Et je me suis très vite donné une ligne de conduite, avec, pour principe, de parler avec franchise. Avec moi, il n’y a pas de lézard. Chacun sait ce qu’il va devoir faire et dans quelles conditions, et cela, sous la direction d’une femme. Chacun est libre d’accepter ou pas. En 2001, il y en a eu quelques uns pour qui ça a été insupportable d’être dirigé par une femme et ils ont quitté le studio ! Mais les mentalités évoluent… En 2005, en fin de production de « Kirikou et les bêtes sauvages » que j’ai co-réalisé avec Michel Ocelot, j’ai eu une conversation intéressante avec quelques garçons de l’équipe. De leur propre aveu, cela avait été compliqué de travailler sous la direction d’une femme, parce qu’ils ne pouvaient pas réagir, avec moi, comme ils le faisaient d’habitude avec un homme, dans les moments de conflits : c’est-à-dire en « montant sur leurs ergots et en gueulant comme des putois », débordants de testostérone. (Elle rit). Avec moi et « mon sourire à la gomme », cela leur aurait paru saugrenu. Et plusieurs m’ont dit avoir dû réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Je suis très fière de les avoir amenés à cette réflexion. En plus, ils semblaient avoir apprécié la sérénité qui en avait découlé. Après, la cheffe n’est pas invitée à tous les barbecues. Mais on s’en remet ». Elle rit.
De ses diverses expériences de « cheffe », Bénédicte retient surtout, qu’à chaque fois, elle a été un objet de curiosité. « Chez les mecs, tu sens qu’ils se demandent pourquoi tu es là, comment tu as fait pour en arriver là… Du côté des filles, c’est très différent : elles se disent « Ah bon, on peut faire ce métier-là, nous aussi ? ».
La question de la confiance en soi et celle de la légitimité sont des problématiques pour un grand nombre de femmes. Jusqu’à Kirikou et les bêtes sauvages, Bénédicte n’envisage pas de passer à la réalisation, malgré une toute première tentative à La Fabrique. « Je m’étais lancée dans l’écriture et la réalisation d’un court-métrage. On a essayé de le présenter à une aide, mais ça n’a pas marché. Par contre, la démarche, je l’avais faite et j’étais allée jusqu’au bout. Plus que de devenir réalisatrice, ce qui me plaisait – et c’est toujours le cas aujourd’hui – c’était de faire un film avec les copains ».
Il faut donc que survienne ce coup de fil de Didier Brunner, en 2004 au cours duquel le producteur lui propose de co-réaliser Kirikou et les bêtes sauvages avec Michel Ocelot. « Michel était en train de réaliser « Azur et Asmar » à Paris. Mais, pour des raisons de production, il fallait en même temps réaliser « Kirikou et les bêtes sauvages » à Angoulême. J’étais très surprise de cette proposition, même si Michel et moi étions des amis. Car le connaissant, j’imaginais bien que l’idée de déléguer une partie de son travail ne devait pas être une chose facile pour lui : il écrit ses scénarios tout seul ; il dessine lui-même ses story-boards ; il supervise la fabrication, au plus près… J’ai eu besoin de l’entendre de sa bouche. Alors je l’ai appelé et il m’a confirmé qu’il était prêt à partager. Il manquait encore deux histoires pour le film, qu’il n’avait pas eu le temps d’écrire. Nous avons donc fait un brainstorming et nous les avons ébauchées ensemble, dont une, à partir d’un pitch de Marine Locatelli. Quant à cette co-réalisation, c’est bien plus tard que j’ai appris qu’elle avait d’abord été proposée à quelques messieurs, mais que ceux-ci avaient tous décliné l’offre ».

Cette co-réalisation était une première pour Michel Ocelot. « Lui aussi, il était un peu inquiet. Mais je l’ai rassuré en lui disant que je ne ferai que du Kirikou et pas sans lui. En même temps, il fallait que je trouve ma place. Alors dans le film, il y a quelques petites entorses par rapport au style de Michel. Mais toutes petites ! (Elle rit). Ça s’est très bien passé, dans l’ensemble, même si certains moments ont mis à mal notre amitié. Et puis le film a fait un carton. Et je lui dois de merveilleux moments, comme la projection devant 2000 enfants à Cannes ou encore la tournée de promotion au Vietnam, dans laquelle on a pu embarquer une partie des techniciens vietnamiens. C’était très émouvant ».
Aujourd’hui, c’est donc à Valence que Bénédicte a posé ses valises pour une nouvelle aventure avec le studio Parmi les lucioles. « Tout est nouveau pour moi : le producteur, Jérôme Duc-Maugé, l’équipe, le format… Et c’est une comédie musicale ! Moi, qui aime le chant – j’ai fait partie d’une chorale – je me régale… ». Et surtout, cette fois, Bénédicte réalise le film, seule. « « Le grand voyage de Gouti », c’est ce que j’appelle un « projet de producteur », dans le sens où c’est Jérôme qui a eu l’idée d’adapter l’album pour enfants de Michel Bussy, illustrée par Peggy Nille, en une comédie musicale composée et interprétée par Olivia Ruiz. Quand il m’a contactée, il y avait un premier séquencier, mais il fallait encore écrire le scénario et toute la partie musicale. Avec Olivia Ruiz, on a dû relever le défi de faire avancer le récit uniquement à travers les paroles des chansons. Nous l’avons fait et nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. D’autant qu’on voulait faire passer les mêmes messages, à travers ce conte qui parle déjà de la nécessité de s’adapter et de s’entraider sur fond de crise climatique. Nous voulions aussi insister sur la nécessité de s’ouvrir à l’autre et de lui tendre la main ».

Comme sur Kirikou et les bêtes sauvages, Bénédicte s’est fondue dans le style graphique d’une autre artiste, l’illustratrice Peggy Nille. « J’aime beaucoup son style à la fois naïf, foisonnant et très coloré qui évoque celui du Douanier Rousseau, mais aussi l’iconographie de l’Inde. C’est un unitaire pour Canal +, mais on aimerait qu’il ait aussi une vie au cinéma, dans un programme de courts-métrages. Seulement avant, il faut le terminer. En tout cas, la fabrication se passe très bien. L’équipe est enthousiaste. Elle est composée de jeunes gens sortant de l’école Emile Cohl et de quelques anciens de la vieille école, comme moi. (Elle rit) Et signe des temps, elle est très féminine ! La parité, c’est aussi une volonté de Jérôme ».
En réalisant un film seule, Bénédicte découvre aussi, pour la première fois, le plaisir de faire des choix, à toutes les étapes de sa fabrication. « J’ai pu notamment accéder à toute la partie montage avec Sylvie Perrin Duc-Maugé. Sur « Kirikou et les bêtes sauvages », c’est Michel qui dirigeait le montage. Moi, je n’ai fait qu’y assister. Là, je prends toute la mesure de ce qu’impliquent les choix qui vont donner son souffle et son âme au film. Et puis, il y a tout ce merveilleux travail sur le son, ce son qui donne une telle dimension aux images. J’ai rencontré des « poètes » du son qui te parlent avec passion du chant des grillons, de ceux qui chantent le jour et d’autres, différents, qui chantent à la tombée de la nuit… C’est génial ! Et puis tu sens qu’avec tous ces talents, avec tous ces passionnés, le film va devenir une petite pépite ».

© Christel Chabert – 2023
Et l’avenir ? Grâce au succès de Kirikou et les bêtes sauvages, Bénédicte confesse qu’elle peut désormais s’autoriser à choisir les projets sur lesquels elle travaille. « Et j’ai la chance qu’il s’en présente de très beaux. J’ai essayé parfois d’en initier mais ça n’a pas marché, pour l’instant ! (Elle rit). Et puis je me suis mise aussi à écrire des scénarios pour des grosses séries. J’avais envie de voir ce qu’impliquait ce type d’écriture, avec toutes les contraintes imposées par la licence. C’est un exercice qui n’est pas facile, mais qui est très intéressant. Je suis une grande curieuse, au fond ; je suis un brin exploratrice. Jean-Christophe Roger, le réalisateur de la série « Belphégor » avec qui j’ai travaillé, m’a dit un jour : « Toi, à chaque fois que tu fais une nouvelle production, on dirait que tu pars sur une nouvelle aventure. ». C’est vrai. Et j’ai eu beaucoup de chance. J’ai travaillé sur de très beaux films, avec des gens très différents, très intéressants, et qui, souvent, sont devenus des amis. J’ai connu des galères et des réussites… Et plein de beaux moments. J’espère que ça va être comme ça jusqu’au bout. Parce qu’il y a encore beaucoup de choses à découvrir et que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre ».
C’est sur ces mots que conclut Bénédicte et sur un grand éclat de rire, comme il se doit.